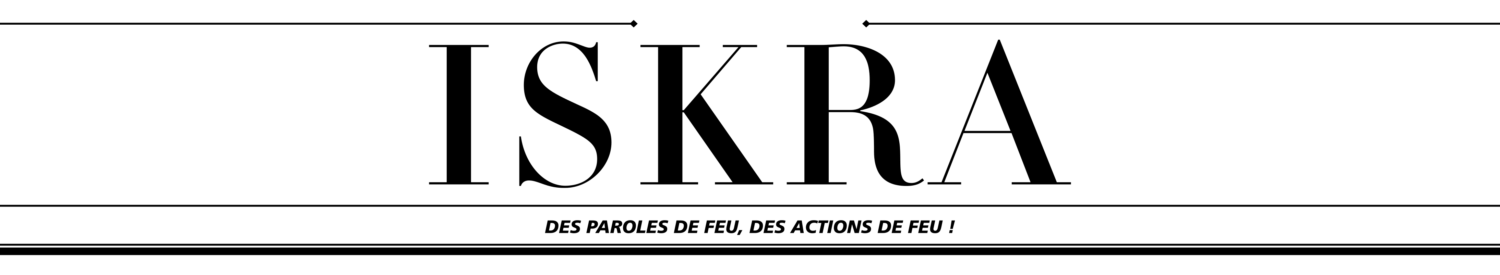La grève chez Meubles Cathedra à Victoriaville et la lutte pour l’élévation des salaires
La grève générale de deux semaines qui vient de prendre fin à l’usine Meubles Cathedra (Division HP Cyrenne) de Victoriaville est un exemple de la lutte ouvrière contemporaine pour l’élévation des salaires au Québec. Le 12 novembre dernier, la vingtaine d’ouvriers spécialisés membres de la section locale 7531 du syndicat des Métallos sont courageusement entrés en lutte contre leurs patrons pour obtenir des hausses salariales suite à l’offre décevante que ces derniers avaient déposée la veille. Ils ont débrayé pendant deux semaines, suscitant de nombreux gestes de solidarité. Hier après-midi, les Métallos ont annoncé que les grévistes avaient voté en faveur d’une entente survenue entre le syndicat et la compagnie. Le contenu de l’entente n’a pas encore été rendu public, mais on peut supposer que les grévistes ont réussi à faire des gains appréciables. Pour les travailleurs de Meubles Cathedra – dont plusieurs faisaient la grève pour la première fois –, l’expérience de lutte aura été enrichissante. Et bien que la grève soit maintenant terminée, leurs revendications – plus que légitimes – auront permis de rappeler à quel point le combat contre la paupérisation de la classe ouvrière est toujours d’actualité.
En effet, l’usine Meubles Cathedra de Victoriaville – une usine où l’on travaille le bois avec des outils spécialisés pour fabriquer des composantes de meubles telles que des pattes de tables et de chaises – fait partie des nombreux établissements industriels au Québec où les salaires sont particulièrement bas. Chez Meubles Cathedra, avant la grève, le taux horaire de base était inférieur à 15 dollars et un ouvrier faisait seulement 14,25 dollars de l’heure au bout de cinq ans. Et pour les travailleurs ayant passé plusieurs décennies à travailler à l’usine, les salaires étaient inférieurs à 20 dollars de l’heure. Par exemple, l’un des ouvriers a déclaré ne recevoir que 16,33 dollars de l’heure malgré ses 30 ans d’ancienneté. Et un autre ne gagnait que 19 dollars de l’heure après plus de 45 ans de travail! En raison de ces conditions salariales dérisoires, les jeunes ouvriers qui commençaient à travailler chez Meubles Cathedra finissaient rapidement par quitter l’établissement pour aller se faire embaucher là où les conditions étaient un peu plus avantageuses.
Lors des dernières négociations, les travailleurs avaient été forcés par les capitalistes de faire des concessions importantes. Mais cette fois-ci, ils étaient déterminés à lutter pour améliorer leurs conditions et ils réclamaient des augmentations de 1 dollar de l’heure pendant trois ans. L’un des ouvriers a déclaré : « Il ne nous reste plus rien à donner. C’est à notre tour de demander ». Et il avait raison, puisque les capitalistes, eux, ont toujours beaucoup à céder. En effet, toutes les richesses qu’ils accumulent provient du surtravail fourni par les ouvriers, c’est-à-dire du temps de travail non payé qu’ils volent aux travailleurs!
Les bourgeois ne seront pas d’accord, mais c’est ainsi que fonctionne le salariat capitaliste. Malgré les apparences, les salaires versés aux ouvriers ne correspondent pas à la valeur réelle du temps de travail qu’ils fournissent aux patrons : en travaillant pendant une heure, les ouvriers produisent bien plus de valeur qu’ils n’en reçoivent en échange. Il faut comprendre que c’est la force de travail des ouvriers qui est achetée par les capitalistes, et non le fruit de leur travail lui-même (que les capitalistes n’ont évidemment pas besoin d’acheter puisqu’ils l’accaparent automatiquement en faisant produire les travailleurs pour eux). Or, la valeur de la force de travail (déterminée par la valeur totale de toutes les marchandises nécessaires à l’entretien, à la reproduction et aux loisirs des ouvriers) est inférieure à la valeur que cette marchandise particulière permet de produire – gratuitement – pour le capital.
On peut supposer que la valeur du surtravail fourni par les ouvriers de Meubles Cathedra était particulièrement élevée étant donné le niveau de leurs salaires. Autrement dit, la plus-value accaparée par les capitalistes qui les exploitent était certainement importante. En faisant la grève, les travailleurs se sont donné les moyens d’arracher au capital une partie supplémentaire de la masse de valeur qu’ils produisent et d’améliorer un peu leurs conditions d’existence. Et ils avaient parfaitement raison de le faire. Cela dit, même s’ils ont réussi à obtenir des augmentations, les ouvriers continueront néanmoins à se faire voler une partie des fruits de leur travail chaque jour. Sinon, les capitalistes cesseraient tout simplement de les embaucher puisque ce ne serait plus profitable pour eux! Par conséquent, même si la grève est terminée, la lutte pour l’élévation des salaires (ou contre leur diminution) va se poursuivre dans les prochaines années : les travailleurs vont continuer à lutter contre le capital pour ramener vers eux la plus grande part possible de la valeur qu’ils produisent. À l’échelle de la société, ce combat ne cessera pas tant que l’exploitation capitaliste sera en place.
Les grévistes ont affronté le Groupe Bermex, un représentant du capital québécois
Meubles Cathedra est la filiale d’une grosse compagnie québécoise spécialisée dans la production de mobiliers pour salle à manger et bistro : le Groupe Bermex. Cette compagnie fondée en 1983 et dont le siège social est basé à Louiseville est aujourd’hui, selon ses propres dires, l’un des trois plus grands fabricants de meubles au Canada. Possédant plus d’une dizaine d’usines (notamment à Louiseville, à Victoriaville, à Beauceville et à Berthierville) et exploitant plus de 600 personnes dans l’une ou l’autre de ses cinq divisions (Bermex, Bertanie, Dinec, Midi et Shermag Canada), la compagnie Groupe Bermex est un représentant relativement important du capital industriel québécois. L’entreprise est en expansion depuis plusieurs années. Après avoir acheté Dinec en 2006 et Midi en 2007, elle a mis la main en 2009 sur l’entreprise en faillite Shermag, dont le chiffre d’affaires s’élevait alors à 45 millions de dollars (tandis que celui du Groupe Bermex était de 48 millions à l’époque). L’entreprise cherche depuis un moment à consolider sa présence sur la marché américain. En 2018, alors qu’elle exportait déjà 50% de sa production aux États-Unis, l’entreprise investissait un million de dollars – avec l’appui financier de l’État bourgeois québécois – afin de développer sa stratégie d’expansion basée sur l’augmentation de ses exportations en Amérique du Nord.
Sur son site internet, en plus de prétendre être « proche des communautés où ses divisions sont établies », la compagnie affirme qu’elle « se veut synonyme d’avancement, de mieux-être et de prospérité. » Considérant la situation des ouvriers de son usine de Victoriaville et les salaires dérisoires qui leur sont versés malgré plusieurs décennies à travailler pour l’entreprise, ce ne sont certainement pas les travailleurs et leurs familles qui bénéficient de cette prospérité. Par contre, ce que l’on peut lire sur le site de la compagnie est tout à fait juste si l’on braque nos projecteurs vers le sommet de l’entreprise. Là, « l’avancement », le « mieux-être » et la prospérité sont effectivement très palpables. On n’a qu’à voir la luxueuse résidence du principal actionnaire de la compagnie, Richard Darveau, pour le constater. Située sur la rue Jean-Paul Riopelle – à côté du club de golf Le Parcours du Cerf – dans un riche quartier de Longueuil caché au milieu de parcs et de boisés, la somptueuse maison du capitaliste Richard Darveau donne une petite idée de la manière dont sont dilapidées les richesses que le Groupe Bermex accumule depuis des années sur le dos de ses ouvriers payés à moins de 15 dollars de l’heure. Le train de vie de ce parasite illustre bien comment le capitalisme répartit les produits du travail : au pôle du capital s’accumulent les fortunes et l’opulence tandis qu’au pôle opposé – celui des ouvriers qui produisent le capital – s’accumulent les petits salaires et la privation!
Des ouvriers reçoivent des salaires misérables partout dans la province
Les ouvriers de l’usine Meubles Cathedra à Victoriaville sont loin d’être les seuls au Québec à recevoir des salaires aussi bas. D’ailleurs, leur grève rappelle celle menée au mois de septembre dernier par les 100 travailleurs de l’usine Energi à Terrebonne (eux aussi membres du syndicat des Métallos) qui, pareillement à eux, réclamaient des augmentations salariales. Dans cette usine de fabrication de portes-patio, les salaires sont également fort peu élevés. Avant la grève, le salaire d’entrée n’était que de 13,35 dollars de l’heure et le travailleur ayant le plus d’ancienneté (25 ans) gagnait moins de 20 dollars de l’heure. Grâce à leur grève, les ouvriers ont réussi à aller chercher des augmentations se situant entre 0,30 dollars et 1,70 dollars de l’heure pour la première année, en plus d’augmentations de 0,25 dollars de l’heure la deuxième, de 0,40 dollars de l’heure la troisième et de 0,35 dollars de l’heure pour chacune des deux dernières années – démontrant que la lutte paie.
Ces luttes sont également à mettre en lien avec le mandat de grève que se sont récemment dotés les quelque 100 travailleurs (encore une fois syndiqués chez les Métallos) de la compagnie AD Prévost à Brossard, où l’on s’adonne à la fabrication de portes et fenêtres en aluminium architectural. Là aussi, les salaires sont bas (ils oscillent entre 14,75 et 24 dollars de l’heure) et les travailleurs veulent obtenir des augmentations, en plus de s’opposer à la volonté des capitalistes d’abolir des postes et d’appauvrir les travailleurs qui les occupent présentement. On peut également penser à l’importante grève menée l’an dernier par les 350 ouvriers de l’usine de la compagnie Olymel (un monopole de l’alimentation employant un nombre significatif d’ouvriers au Québec) à Princeville. Avant la grève organisée par la CSN, le salaire d’entrée à l’usine de Princeville était de 15,09 dollars de l’heure et plafonnait à 19,91 dollars de l’heure. Entre 2004 et 2005, les salaires avaient chuté de plus de 25 pourcents (un ouvrier qui faisait 24 dollars de l’heure en 2004 ne faisait plus que 14,75 dollars de l’heure un an plus tard…). Depuis, les travailleurs n’avaient jamais réussi à récupérer ce qu’ils avaient perdu.
On pourrait penser que ces exemples particuliers ne sont pas représentatifs de la condition générale de la classe ouvrière au Québec. Mais lorsque l’on jette un œil aux statistiques disponibles, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas du tout de cas isolés. En parcourant le document « Salaires par professions présentés par intervalles selon les quartiles au Québec » publié par le gouvernement du Québec au mois de juillet dernier, on tombe sur des données révélatrices. On y constate par exemple que le salaire horaire médian (basé sur les heures de travail habituellement payées pour une semaine, y compris les heures supplémentaires, ce qui signifie que les salaires payés lors d’une semaine normale sont encore plus bas) pour les « opérateurs de machines » se situe aux alentours de 20 dollars, et bien souvent en dessous de ce montant. Par exemple, le salaire horaire médian des « opérateurs de machines à travailler le bois » se situe entre 16 et 17,99 dollars et celui des « opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux », des « opérateurs de machines de traitement des matières plastiques » et des « opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons » se situe entre 18 et 19,99 dollars. Rappelons que le salaire médian est celui qui divise l’ensemble des ouvriers en deux parties égales, ce qui signifie que 50% de ces ouvriers reçoivent des salaires inférieurs ou égaux à ce salaire. Les données étant réparties par quartiles, on constate également qu’un nombre considérable d’opérateurs de machines reçoivent des salaires bien plus bas. Par exemple, 25% des « opérateurs de machines à travailler le bois », des « opérateurs de machines de traitement des matières plastiques » et des « opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons » reçoivent un salaire horaire inférieur à un montant se situant dans l’intervalle entre 14 et 15,99 dollars! Et c’est sans parler des manœuvres dans la production, dont les salaires sont généralement encore plus bas que ceux des opérateurs de machines. Par exemple, le salaire horaire médian des « manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons » se situe entre 14 et 15,99 dollars, et 25% d’entre eux font un salaire horaire inférieur à un montant se situant entre 12 et 13,99 dollars!
D’autres sources fournissent des informations semblables. Selon le site de recherche d’emplois québécois Neuvoo, le salaire horaire moyen (basé sur 1 583 salaires) pour un « opérateur de machine » au Québec n’est que de 17,50 dollars de l’heure. Selon Statistiques Canada, en 2019, le solaire horaire médian dans le secteur de la « fabrication » était de 23,08 dollars au Québec (incluant le personnel non ouvrier comme les cadres ou les ingénieurs, ce qui peut expliquer pourquoi le montant est légèrement supérieur à ce que révèlent les données des sources précédentes).
Finalement, si l’on quitte la stricte observation du secteur manufacturier pour avoir un portrait encore plus général de la situation du prolétariat québécois, c’est encore le même tableau qui se présente à nous. En 2017, selon Revenu Québec, 37,25% des québécois gagnaient moins de 25 000 dollars par année, et un autre 29,47% avaient un revenu annuel inférieur à 50 000 dollars. Nul besoin de mentionner que ces deux fractions de la population sont certainement constituées par une écrasante majorité d’ouvriers et de travailleurs!
La solution à la paupérisation : l’abolition du salariat
Alors que plusieurs clament depuis des décennies que l’exploitation n’existe plus dans les pays riches et que les prolétaires d’autrefois se seraient « embourgeoisés », les luttes comme celle qu’ont menée les travailleurs de l’usine Meubles Cathedra prouvent le contraire de façon éclatante. Mais pour avoir accès à cette preuve, il faut s’intéresser aux combats économiques qui se développent dans le mouvement ouvrier actuel, ce que ne font justement pas les petits-bourgeois remplis de préjugés qui pensent que le prolétariat n’existe plus. Il faut dire que les grands médias capitalistes ne rendent pas la tâche facile à quiconque essaie de voir la société du point de vue de ceux d’en bas et d’avoir un portrait de la situation générale de la classe ouvrière contemporaine. Comme l’a déclaré un des grévistes de Meubles Cathedra : « C’est pas TVA qui va parler de nous autres ». C’est pourquoi les ouvriers ont besoin d’un journal comme l’ISKRA pour documenter l’existence de leur classe sociale et pour concentrer leurs revendications et leurs intérêts fondamentaux.
Le fait qu’autant de travailleurs reçoivent encore des salaires aussi dérisoires après plus d’un siècle de luttes ouvrières importantes – et fructueuses dans bien des cas – ne fait que démontrer la vérité marxiste selon laquelle le mode de production capitaliste conduit inéluctablement à la paupérisation du prolétariat. Non pas que la lutte spontanée menée par les ouvriers pour l’élévation des salaires soit inutile – bien au contraire –, car sans elle, les conditions de vie de la classe ouvrière sombreraient à un niveau de dégradation extrême. Mais mener cette lutte sans travailler également à l’émancipation complète et définitive de la classe laborieuse, cela revient à effectuer une tâche interminable : à rouler le rocher de Sisyphe.
Le capital fait toujours pression pour abaisser à nouveau le niveau des salaires que les ouvriers l’ont précédemment forcé à hausser. Et de manière générale, il finit par avoir le dessus sur les ouvriers, malgré leur résistance. En effet, avec le progrès de l’industrie et de la production capitaliste, la partie du capital existant sous la forme de moyens de production (machines, bâtiments, etc.) tend à augmenter plus rapidement que la partie du capital servant à l’achat de la force de travail : les machines et les instruments sont de plus en plus sophistiqués et rendent le travail plus productif. Il en résulte que la demande de travail tend à augmenter moins vite que l’accumulation du capital, ce qui donne un avantage décisif aux capitalistes dans leur lutte contre les ouvriers. Ainsi, le développement même de la production capitaliste tend à faire baisser le niveau moyen des salaires, à repousser plus ou moins la valeur de la force de travail vers son minimum. Et même lorsque les salaires augmentent, la part des richesses accaparée par les capitalistes croit généralement encore plus vite, aggravant la situation relative des ouvriers par rapport à celle des bourgeois.
Toutes sortes de statistiques le confirment. Par exemple, selon une fiche technique publiée en 2019 par l’Institut de recherche en économie contemporaine, la part du PIB correspondant à la « rémunération du travail » au Québec est passée de 58,4% en 1981 à moins de 53% en 2017, alors que la part correspondant aux « profits des entreprises » est passée de 22,1% à près de 25% pendant la même période. Selon une étude publiée par Statistique Canada en 2018, les revenus des hommes de 25 à 54 ans ont diminué de 5% (et ceux de l’ensemble des hommes de 8%) en tenant compte de l’inflation entre 1976 et 2015 dans l’ensemble du pays. Certes, les revenus des femmes ont beaucoup augmenté pendant la même période – compensant les pertes chez leurs homologues masculins –, mais cela est principalement dû au fait qu’elles se sont mises à travailler davantage. D’autres données fournies par Statistique Canada montrent que les salaires horaires médians des hommes âgés de 25 à 34 ans travaillant à temps plein ont baissé de 4% entre 1981 et 2012 (et même de 6% si l’on exclut les provinces productrices de pétrole) à l’échelle nationale.
La seule solution véritable à la paupérisation, c’est l’abolition de sa cause, c’est-à-dire de l’exploitation salariale elle-même. Sous le capitalisme, il n’y a pas de salut pour la classe ouvrière. En plus des grèves et des combats économiques actuels, il faut se préparer à mener la lutte finale : la lutte pour que les travailleurs deviennent les maîtres de la production et pour qu’ils contrôlent collectivement les fruits de leur travail.