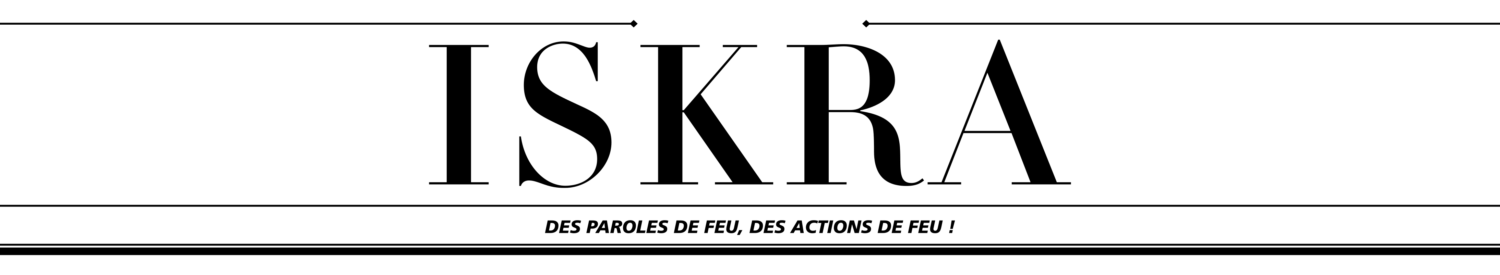COVID-19 : De la « gratitude » au mépris décomplexé des travailleurs
Au début de la crise sanitaire, et spécialement pendant le confinement général, la bourgeoisie ne cessait d’encenser publiquement les travailleurs « essentiels » et d’exprimer de la gratitude pour leurs efforts centraux dans la lutte contre la pandémie. Au Québec, les travailleuses de la santé étaient appelées des « anges gardiens » par le premier ministre. Les prolétaires des différents secteurs encore en activité étaient remerciés quotidiennement par les politiciens. Dans les médias bourgeois, on parlait soudainement de l’importance de leur travail. Leur réalité quotidienne était tout à coup exposée au grand jour. Pour une rare fois, il était presque possible de prendre conscience au téléjournal ou à la radio de l’existence de la classe prolétarienne, la classe sociale majoritaire sur laquelle repose toute la société, mais dont on ne parle pourtant jamais dans l’espace public officiel. Plus encore, pendant la même période, une partie des travailleurs « essentiels » se sont vus accorder des primes monétaires par les capitalistes et par le gouvernement. Les travailleurs du secteur de la production alimentaire et des supermarchés ont par exemple bénéficié d’une prime de deux dollars de l’heure pendant les premiers mois de la crise. Ces primes étaient censées exprimer une forme de reconnaissance pour les efforts exceptionnels de certains travailleurs. Pour les autres qui avaient perdu momentanément leur emploi, le gouvernement fédéral offrait une « prestation d’urgence » officiellement censée témoigner du soutien solidaire de toute la population par les autorités.
Plusieurs mois plus tard, force est de constater que cette « reconnaissance » n’aura pas duré longtemps. Lorsque la bourgeoisie a amorcé la phase de la relance économique au mois de mai dernier, les remerciements envers les travailleurs « essentiels » ont progressivement laissé la place à l’indifférence la plus complète à leur égard. Les autres prolétaires ont reçu l’injonction de retourner au travail au plus vite, malgré les risques pour leur santé. Très vite, les capitalistes du secteur de l’alimentation et du commerce de détail ont retiré leurs primes à leurs employés. La prestation d’urgence fournie par le gouvernement fédéral – prestation qui, déjà, ne représentait pas grand-chose contrairement à ce que certains porte-paroles patronaux essayaient de faire croire – est devenue plus chiche pour forcer le retour au travail malgré le danger. Les travailleuses de la santé ont cessé de recevoir des louanges et leurs cris de détresse ont continué d’être ignorés malgré l’aggravation de leur situation. Les attaques ouvertes contre les prolétaires se sont multipliées et des compagnies comme Metro n’ont pas hésité à mettre des centaines de travailleurs en lock-out. Et pour couronner le tout, les prolétaires craignant pour leur santé et pour leur vie en raison du danger grandissant sur leurs lieux de travail – comme les ouvriers de l’usine Olymel de Vallée-Jonction où une éclosion majeure a récemment éclaté – ne sont pas entendus et se voient forcés de continuer à travailler dans les pires conditions.
On peut se demander ce qui a changé en si peu de temps dans la société. Mais en vérité, rien n’a changé. Car en fait, les remerciements et les louanges du début de la crise n’étaient pas l’expression d’une réelle gratitude de la bourgeoisie à l’endroit des prolétaires. En effet, ces déclarations ne servaient à rien d’autre qu’à favoriser le ralliement derrière les décisions de l’État bourgeois et de la classe capitaliste dans une période d’incertitude et d’instabilité grandissante. Autrement dit, le discours officiel de la bourgeoisie mettait de l’avant l’unité, la solidarité et l’entraide dans le but de masquer au maximum l’antagonisme de classes qui caractérise la société capitaliste. Mais cette « unité » était complètement illusoire. La lutte des classes ne s’est pas arrêtée avec le début de la crise sanitaire. Et comme on le voit maintenant, la « gratitude » des premiers mois de la crise a laissé la place au mépris habituel des prolétaires.
Les employés de trois grandes entreprises sont en lock-out depuis plus d’un mois au Québec
À la fin du mois de septembre, les 700 employés de l’entrepôt central de Jean Coutu à Varennes, les 50 ouvriers de l’usine d’emballages en carton WestRock à Pointes-aux-Trembles et les 25 chauffeurs de bétonnière de l’usine Demix Béton à Saint-Hubert ont été sauvagement mis en lock-out par leurs employeurs. Plus d’un mois plus tard, les travailleurs touchés sont toujours privés de leur emploi et de leur salaire. Alors que de nombreuses familles prolétariennes ont déjà été grandement appauvries par les pertes d’emploi ou d’heures de travail liées au confinement du printemps dernier – les revenus perdus n’ayant bien souvent pas été compensés par « l’aide » modeste de 500 dollars imposables par semaine accordée par le gouvernement fédéral –, mettre des travailleurs à la rue pendant plusieurs semaines, comme le font les capitalistes de Metro (le monopole qui détient le Groupe Jean Coutu), de WestRock et de Demix Béton est tout simplement ignoble.
Dans le cas du lock-out des 700 ouvriers de l’entrepôt central de Jean Coutu – entrepôt qui approvisionne les 415 pharmacies Jean Coutu du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick –, les agissements de la compagnie ajoutent également aux difficultés des masses populaires en général en occasionnant, en pleine deuxième vague de la pandémie, des problèmes dans l’approvisionnement en médicaments. Deux semaines après le début du lock-out, on constatait déjà que certaines pharmacies refusaient de renouveler des ordonnances pour plus d’un mois – obligeant certains clients à se déplacer plus souvent au moment où il faut limiter les contacts sociaux pour ralentir la propagation du virus. Pire encore, les lock-outés viennent d’avoir la confirmation que le Groupe Jean Coutu fait présentement travailler des scabs dans son entrepôt, une pratique qui est illégale au Québec. Bref, la compagnie Metro, qui feignait d’être « solidaire » de ses employés au printemps dernier en leur versant des primes de deux dollars de l’heure, révèle son vrai visage. Après avoir bénéficié de la publicité entourant le versement de cette fameuse prime (le PDG multimillionnaire de la compagnie ayant même été invité à l’émission Tout le monde en parle au début de la crise pour vanter la grandeur d’âme de l’entreprise qu’il dirige), la compagnie n’hésite plus à écraser impitoyablement ses employés. Autrement dit, maintenant que les projecteurs sont braqués ailleurs, tout est permis. Et cela tombe bien puisque les profits records dont l’entreprise a profité grâce la pandémie ne semblent pas suffisants pour ses propriétaires : ceux-ci semblent déterminés à saigner les travailleurs jusqu’au bout pour les faire augmenter davantage.
Évidemment, le premier ministre du Québec François Legault, lui qui n’a cessé de dire que tout le monde devait s’unir pour lutter contre la pandémie, n’a pas jugé bon de dénoncer les agissements des capitalistes qui mettent leurs employés à la rue au beau milieu de la deuxième vague. Pourtant, si l’on se fie à son historique de déclarations publiques acrimonieuses contre les syndicats, on peut supposer qu’il n’hésiterait pas à dénoncer les travailleurs pour leurs agissements « irresponsables » s’il s’agissait de grèves et non de lock-outs!
Les monopoles de l’alimentation et du commerce refusent de réinstaurer les primes malgré la recrudescence de l’épidémie
Au début du mois de juin dernier, les monopoles de la distribution et de la production alimentaire Metro, Sobeys, Loblaw et Olymel annonçaient qu’ils allaient mettre fin à la prime de deux dollars de l’heure qu’ils versaient à leurs employés. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, d’autres géants du commerce de détail, comme Dollorama et Couche-Tard, ont emboîté le pas et ont également mis fin aux primes qu’ils versaient depuis le début de la crise sanitaire.
Alors que beaucoup de prolétaires s’attendaient à ce que ces primes demeurent au moins jusqu’à la fin de la pandémie, leur retrait après seulement trois mois – et dans un contexte où le virus circulait toujours – confirmait que la « générosité » des capitalistes n’était qu’un mirage. D’ailleurs, les primes n’étaient pas des cadeaux (contrairement à ce que les grandes entreprises ont mis de l’avant pour se donner une belle image), mais des augmentations de salaire négociées par les syndicats pour compenser minimalement les risques et les efforts supplémentaires consentis par les travailleurs des secteurs essentiels (dont un bon nombre reçoivent des salaires particulièrement peu élevés) dans le contexte de la pandémie.
Évidemment, le retrait des primes a été vivement dénoncé par les syndicats représentant les travailleurs concernés. Pendant l’été, les syndicats des usines et de l’entrepôt d’Olymel affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) ont formé un front commun – représentant des milliers d’ouvriers au Québec – et ont organisé des manifestations pour faire reculer la compagnie. Malheureusement, les capitalistes n’ont rien voulu entendre. On aurait cependant pu penser qu’avec l’arrivée de la deuxième vague, les grandes entreprises de l’alimentation et du commerce de détail consentiraient à compenser à nouveau leurs employés pour le danger grandissant auquel ils sont exposés chaque jour. Mais cela aurait été faire preuve de naïveté. Malgré la recrudescence de l’épidémie et la multiplication des éclosions dans les milieux de travail, les capitalistes refusent de réinstaurer les primes. La FC-CSN s’est d’ailleurs activée à nouveau récemment pour réclamer le retour d’une compensation monétaire pour les risques de plus en plus grands encourus par les travailleurs. Le président de l’organisation syndicale, en plus de s’être fait entendre dans les médias, a livré un discours enflammé à ce propos lors d’un rassemblement filmé des lock-outés de l’entrepôt Jean Coutu.
Notons que dans le cas d’Olymel, non seulement l’entreprise refuse toujours de compenser ses employés pour les risques élevés qu’ils continuent de prendre chaque jour (rappelons que le secteur de l’abattage s’est révélé être particulièrement propice aux éclosions pendant la première vague en Amérique du Nord et en Europe), mais elle oblige présentement les 1 050 ouvriers de son usine de Vallée-Jonction à continuer de travailler malgré une éclosion majeure ayant conduit à l’infection d’au moins 126 travailleurs et à la mort de l’un d’entre eux. En effet, en dépit des demandes du syndicat, l’entreprise – avec l’appui des autorités sanitaires de la région – refuse de fermer l’établissement pour ne pas nuire à ses profits. On voit que les messages de remerciement du printemps envers leurs employés n’étaient que pure hypocrisie et qu’en réalité, les dirigeants d’Olymel ne se soucient aucunement de la santé – et même de la vie! – des prolétaires qu’ils exploitent, comme tous les représentants du capital.
Les travailleuses de la santé sont encore traitées comme de la chair à canon
Alors que le gouvernement du Québec les appelait hypocritement ses « anges gardiens » au début de la crise, les travailleuses de la santé (infirmières, infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires, etc.) se trouvaient plongées dans une situation absolument épouvantable. Au moment même où le gouvernement les remerciait chaque jour devant les médias, ce même gouvernement les forçait, à l’abri des regards du public, à travailler dans des conditions dangereuses, sans équipement de protection suffisant et sans consignes adéquates, et les privait de leurs droits syndicaux à coups d’arrêtés ministériels. En conséquence de ce traitement inhumain, près de 17 000 travailleuses ont été infectées par le virus entre le début de l’épidémie et la mi-octobre, sur lesquelles plus de 400 ont dû être hospitalisées et un peu plus d’une dizaine sont décédées. Par ailleurs, les conditions de travail infernales qui leur ont été imposées ont aussi eu des conséquences désastreuses sur la population en général. En effet, la gestion anarchique du système de santé par la bourgeoisie a, entre autres, mené à l’hécatombe que la province a connue dans les CHSLD, où des milliers de prolétaires âgés sont morts à cause de la propagation incontrôlée du virus.
Et à présent, alors que la deuxième vague frappe la province – et que les autorités bourgeoises ont eu plusieurs mois de « répit » pour se préparer –, les problèmes que décrient les travailleuses de la santé et leurs syndicats ne sont toujours pas réglés. Encore aujourd’hui, la plupart d’entre elles n’ont toujours pas accès à des masques N95 (les masques les plus efficaces pour se protéger des aérosols infectieux en suspension dans l’air), une situation que les syndicats ont encore été obligés de dénoncer récemment. Et c’est sans parler des problèmes de manque d’effectifs et de mouvements de personnel qui ne sont toujours pas solutionnés.
Pour ajouter l’insulte à la blessure, les autorités bourgeoises – qui ont depuis longtemps cessé de remercier leurs « anges gardiens » dans les médias –, ne cessent d’accuser les milliers de travailleuses qui ont été infectées dans les derniers mois d’être responsables de leur situation puisqu’elles auraient soi-disant relâché la garde pendant leurs pauses – une affirmation particulièrement odieuse lorsqu’on sait que c’est le manque d’équipement de protection qui a mené à leur contamination. Et c’est sans parler du fait que les consignes qu’elles ont reçu tout au long de la crise étaient complètement incohérentes et inadéquates – les autorités sanitaires ayant, notamment, toujours refusé de reconnaître que le virus se transmettait par « voie aérienne » bien au-delà de deux mètres.
Pour couronner le tout, le gouvernement Legault refuse toujours de faire des offres acceptables à ses « anges gardiens » dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leurs conventions collectives (qui sont échues depuis le 31 mars dernier), s’entêtant à maintenir leurs conditions de travail à un niveau médiocre pour les années à venir. Par ailleurs, les nouvelles préposées aux bénéficiaires issues du programme de formation accélérée de cet été et qui s’étaient fait promettre sur la place publique des salaires de 26 dollars de l’heure par le gouvernement ont constaté à leur arrivée dans le réseau de la santé qu’elles se sont fait mener en bateau par le premier ministre. En effet, elles ne toucheront finalement ce salaire que si elles travaillent à temps plein et sans jamais s’absenter (que ce soit pour un congé personnel ou pour un congé de maladie), puisque la somme de 26 dollars de l’heure promise par le gouvernement est en fait composée de montants forfaitaires qui s’ajoutent à la dernière paie de chaque mois si l’employé a respecté toutes les conditions… Et pour finir, ajoutons que les prolétaires récemment arrivés au Canada en tant que demandeurs d’asile et ayant travaillé comme préposés aux bénéficiaires ou comme infirmiers pendant la première vague – et qui s’étaient fait promettre la régularisation de leur statut en « reconnaissance » de leur contribution – ne savent toujours pas quand le processus sera mis en branle. Pire encore, ils ont appris au mois d’août dernier qu’ils ne seront admissibles au nouveau programme de régularisation que si leur situation répond à certains critères restrictifs. En guise de remerciement pour leurs efforts, des « anges gardiens » pourraient donc éventuellement être expulsés du pays!
Il n’y a pas d’unité possible entre la bourgeoisie et le prolétariat
Comme on le constate, pour la classe capitaliste, les prolétaires ne représentent rien d’autre qu’une force de travail à exploiter au maximum. Et s’il faut sacrifier la santé et la vie d’une partie d’entre eux pour assurer la bonne « santé » du capital, la bourgeoisie et ses représentants politiques n’hésitent pas à le faire. Dans la société bourgeoise, les discours sur « l’unité » de toute la population ne sont qu’une hypocrisie de la pire espèce. Il ne peut y avoir d’unité entre les exploités et les exploiteurs. Et même pendant les crises les plus graves, la lutte des classes ne s’arrête jamais!