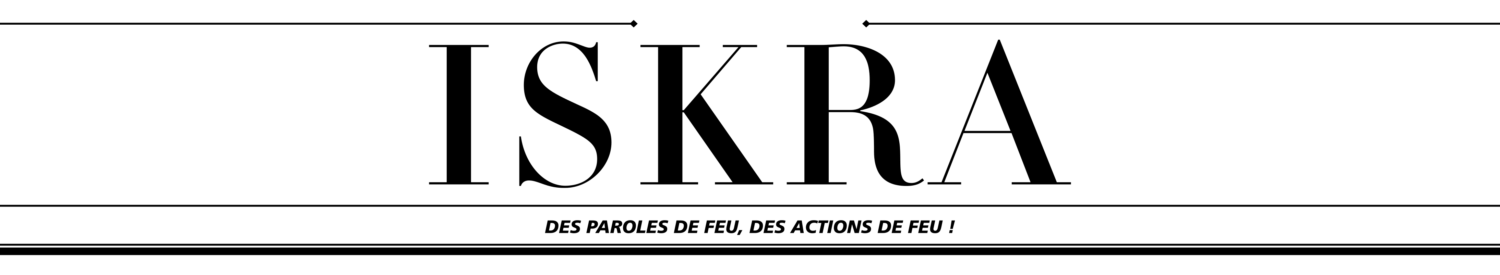La course à la chefferie et la débandade du Parti québécois
À l’échelle du Québec, la débandade du Parti québécois est un fait politique important de notre époque. Elle nous permet d’analyser les objectifs économiques et politiques de la bourgeoisie de même que les rapports de force au sein du parlement et d’autres sphères de l’État capitaliste. Derrière l’impasse dans laquelle se trouve le PQ se cache l’abandon unanime du séparatisme par l’ensemble des sections importantes et sérieuses du capital québécois qui, sans jamais avoir majoritairement opté pour cette voie, l’avaient tout de même défendue, du moins partiellement, pendant toute une époque historique.
Le projet indépendantiste, loin de s’être conclu par une défaite, s’est soldé par la réalisation des grandes revendications de la bourgeoisie québécoise sous une autre forme que celle de la séparation du Québec du reste du Canada. Le tout a été accompagné par la réorganisation du capital au Canada. En somme, le capital québécois est entré dans la cour des grands, celle des joueurs impérialistes. C’est dans cette réalisation complexe que se trouve l’origine de la disparition du mouvement indépendantiste, mouvement ayant défini des générations de politiciens bourgeois et ayant introduit son lot de confusion dans la lutte sociale au Québec.
Une course à la chefferie sans candidat ayant du potentiel et du talent : le reflet d’un parti sans tâche historique et sans contrat parlementaire
Les derniers résultats électoraux enregistrés par le PQ n’étaient pas glorieux : 9 députés élus sur 125 parlementaires. La tournure que prend en ce moment la course à la chefferie de ce parti ne fait que confirmer la tendance. En réalité, le parti n’est plus dépositaire d’aucune tâche historique dans la société. Son contrat parlementaire, qui consistait à former, en alternance, soit l’opposition officielle, soit le gouvernement, n’a d’ailleurs pas non plus été renouvelé aux dernières élections. Le parti n’est plus vu comme un aspirant crédible à l’exécutif national.
C’est ce vide que représentent les quatre candidats à la chefferie que sont Frédéric Bastien, Sylvain Gaudreault, Guy Nantel et Paul Saint-Pierre Plamondon. Des quatre candidats, seul Sylvain Gaudreault a été député élu et ministre. Il a aussi a été chef intérimaire en 2016 suite au départ de Pierre Karl Péladeau, ce dernier ayant relancé temporairement les espoirs souverainistes lors de son court passage à la tête de la formation politique en 2015. Frédéric Bastien et Paul Saint-Pierre Plamondon sont, quant à eux, deux universitaires sortis des boules à mites, soit des dernières réserves du parti. Le premier, historien de formation, s’est fait connaître pour avoir rédigé La bataille de Londres portant sur les manœuvres politiques entourant le rapatriement de la constitution canadienne en 1982, ainsi que pour avoir rédigé son essai Après le naufrage : jugement sur l’État du PQ. Le second, est l’ancien frère d’armes de Mélanie Joly dans le groupe de réflexion politique Génération d’idées fondé en 2009. Il est avocat et auteur de Relancer le camps du Oui ainsi que du rapport Osez repenser le PQ. Pour sa part, Guy Nantel, nouvellement arrivé dans les rangs du parti, est un humoriste des plus haïssables ayant fait carrière en se moquant des gens ordinaires. Sa popularité a attiré quelques nouveaux adhérants au PQ sans non plus provoquer le raz-de-marée escompté.
Ce qui relie ces quatre candidats, ce sont les illusions idéologiques et les perspectives déconnectées de la réalité dans lesquelles s’enfonce le Parti québécois tout entier. Le premier débat tenu le 26 août dernier en a fait la démonstration. Chacun y est allé de ses conceptions particulières sur « le joug fédéral » et sur « l’oppression nationale ». Il a été question de la soi-disant corruption systématique des institutions québécoises et des politiciens québécois au moyen de pots-de-vin en provenance d’Ottawa. Lors de ce débat minable, l’on a aussi abordé des questions hyper précises sur un éventuel Québec souverain : les taxes prélevées sur les bateaux empruntant le fleuve Saint-Laurent, les personnages historiques qui figureraient sur la monnaie québécoise, les contributions militaires du Québec à l’OTAN, etc. Une grande part du débat a aussi porté sur les éventuels gestes de rupture qu’adopterait chacun des candidats en lice pour atteindre l’indépendance, outre la tenue (ou non) d’un référendum lors d’un premier mandat.
Le parti est prisonnier d’une dynamique particulière. Au fond, dans les conditions actuelles propres au PQ, chacun des candidats adopte la tactique requise pour remporter la course à la chefferie. Cela dit, cette tactique n’est pas celle que requiert un résultat satisfaisant aux prochaines élections, voire un contrat parlementaire durable ou, du moins, de courte durée. Autrement dit, pour être élu à la tête du parti, les candidats durcissent la ligne en matière d’indépendance, alors que pour relancer ce parti bourgeois en déroute, il faudrait revoir complètement l’article 1 de son programme concernant la réalisation de l’indépendance du Québec, voire s’en défaire définitivement. L’ennui, c’est qu’il ne reste que des partisans invétérés du mouvement indépendantiste dans les rangs du parti, mais il ne s’agit plus de représentants sérieux des intérêts économiques capitalistes dans la société. D’un côté, l’on retrouve de vieux indécrottables qui n’ont pas « décroché » et de l’autre, des jeunes plein d’illusions qui ont des conceptions erronées. Les membres du PQ cherchent donc à élire le plus nationaliste des aspirants chefs. Pour plaire à la base péquiste, les candidats cherchent donc à se démarquer, quitte à verser dans le ridicule sur des questions anachroniques ou encore trop pointues pour être prises au sérieux à l’heure actuelle. À vrai dire, ceux qui étaient partisans d’une transformation du PQ vers un organe de pouvoir bourgeois délivré des freins historiquement dépassés ont déjà quitté le navire depuis quelques temps : ils sont passés à la CAQ ou au PLQ, dans une moindre mesure. Il sont allés là où le pouvoir était possible, là où les contrats parlementaires de gouvernance et d’opposition officielle ont le potentiel d’être attribués.
Un PQ inévitablement en déclin et un parlement qui tombe en désuétude
Il ne s’agit pas ici de prédire la mort imminente du PQ : cette formation politique bourgeoise n’a peut-être pas dit son dernier mot. Cela dit, une chose est certaine : le PQ de l’indépendance du Québec est mort depuis longtemps déjà. Les tâches liées à l’essor économique de la bourgeoisie québécoise ont été accomplies, mais sous une forme qui a différé de celle qui avait été initialement envisagée. Aujourd’hui, l’allure que prennent les débats et l’obstination de certains militants du PQ à défendre la séparation de la province du reste du pays témoignent de la déconnexion du parti avec l’histoire ainsi que de la cécité de ses partisans.
Le gouffre dans lequel s’enlise le PQ s’accentue d’année en année depuis le début de la dernière décennie. Pourtant, ce parti a été au pouvoir cinq fois, soit en 1976, 1981, 1994, 1998 et 2012, et lorsqu’il ne l’était pas, il formait l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, soit en 1973, 1985, 1989, 2003 et 2014. Deux de ses mandats ont marqué l’histoire nationale de par la tenue des référendums de 1980 et de 1995. La force et le poids du mouvement nationaliste en a fait un parti d’opposition et de gouvernance sérieux et éprouvé durant une certaine époque. Le PQ a cumulé énormément d’expérience en matière de gestion des affaires publiques et de réalisation de projets ministériels. Il a rassemblé en son sein plusieurs fonctionnaires et gestionnaires compétents, et ce, car dans les années 1960 et 1970, il résidait une proximité entre le mouvement nationaliste (et par extension le PQ) et la réalisation des tâches démocratiques et économiques dans l’État, la production et la culture. C’est toute une génération de bourgeois et de petits-bourgeois qui a été formée à travers ce parti : l’économie nationale et l’État québécois en général prenaient de l’expansion, ce qui requérait d’un seul coup des gens en grand nombre pour combler des postes nouveaux. Mais plusieurs décennies après sa fondation, le vent a progressivement tourné, d’abord en 2007 lorsque l’ADQ a fait une percée inattendue, puis en 2018, lorsque Jean-François Lisée a été défait et que le parti est tombé en disgrâce, passant au rang de la 3e opposition, voire presque de la 4e, ex aequo avec QS.
Après le référendum perdu de 1995 et la dégringolade du mouvement nationaliste au Québec, la dernière tentative de réhabilitation du PQ est venue sous Bernard Landry et ce, suite au départ de Jacques Parizeau, puis de son lieutenant quelques temps plus tard, soit Lucien Bouchard. Cette tentative a même connu de sérieux succès. Le parti s’est donc transformé en option crédible de gouvernance et d’administration du capital, ce qui a assuré sa survie pendant quelques années. Le sauvetage organisé par Bernard Landry a fait prendre au PQ une orientation à saveur sociale-démocrate et réformiste, le parti recyclé prêtant le flanc à « la gauche », ce qui lui a plutôt réussi et qui lui a valu de se maintenir au pouvoir pendant quelques années encore. Sa crédibilité ayant été sauvegardée et prolongée, le PQ a pu se hisser de nouveau au pouvoir en 2012 pour réaliser une sortie de crise, car il s’agissait d’une nécessité tactique pour la bourgeoisie que d’en finir avec la grève étudiante des cégeps et des universités, et ce, en venant calmer le jeu, a contrario des Libéraux de Jean Charest. Le mandat n’a finalement été que de deux ans et a signé l’arrêt de mort du PQ au pouvoir. Depuis, aux suites du départ de Pauline Marois (emportant avec elle les derniers vestiges de l’époque de René Lévesque), l’on a l’impression que le parti n’est animé que par une interminable course à la chefferie dans laquelle le magnat Pierre Karl Péladeau a surnagé, puis jeté la serviette, suivi du pédant Jean-François Lisée, pour en finir avec une ribambelle de candidats tous plus clownesques les uns que les autres. C’est aussi dans cette foulée que le PQ a misé sur les « valeurs québécoises » avec l’odieuse charte de Bernard Drainville ciblant les immigrants, ce qui s’est avéré être un coup de grâce pour la formation politique. En vrai, pendant que le désespéré PQ jouait avec le feu, la CAQ devenait une formation plus optimale et fonctionnelle surfant habilement sur les mêmes thématiques et idées, mais sans s’enfarger dans l’indépendance à tout prix et sans l’embarras que constituaient les échecs péquistes passés (la popularité des partis connaissant une usure accélérée en politique bourgeoise). La dissolution de l’ADQ et son intégration à la CAQ a d’ailleurs confirmé l’intérêt pour un renouveau politique.
Il ne reste du PQ qu’une course à la chefferie loufoque. Le prolétariat, lui, ne se soucie que de questions très conjoncturelles en matière de politique bourgeoise, ce qui écarte les partis qui s’adonnent à des divagations sur un Québec indépendant. Mais le véritable désaveu envers le PQ provient de la haute bourgeoisie qui n’en a plus rien à faire de l’indépendance de la province. D’ailleurs, la plupart des députés, carriéristes et politiciens se sont détournés de cet objectif obsolète. Ceci étant dit, l’avenir des autres partis bourgeois n’en est pas moins incertain. La seule certitude, c’est que le pouvoir politique bourgeois bien en place n’est plus dépositaire d’aucun progrès historique dans la société depuis belle lurette. Le parlement est un instrument politique désuet et plus le temps passera, plus les partis politiques bourgeois y siégeant auront du mal à se « revamper ».