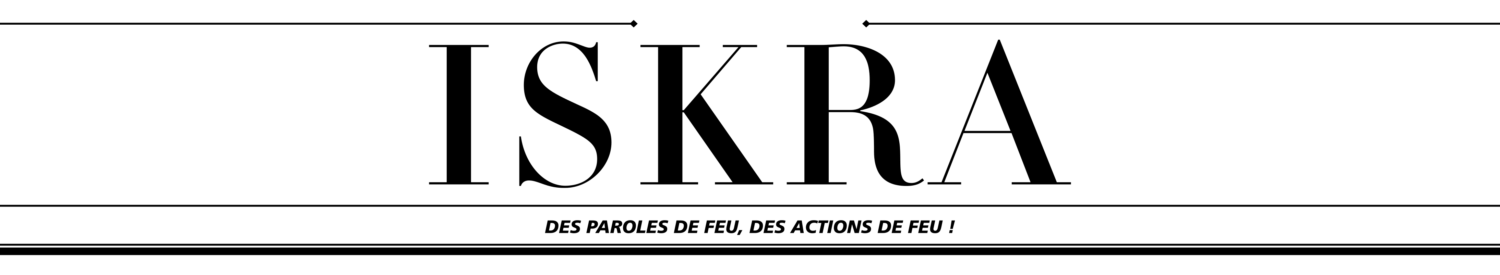COVID-19 : L’impact des dépenses, du déficit et de la dette publique
La reprise généralisée de l’économie capitaliste est bien entamée et au fil des semaines, de nouvelles étapes seront franchies. Les capitalistes et leur État veulent accélérer et faciliter le processus d’ensemble de l’activité économique qui a été relancée. C’est d’ailleurs animé par cette motivation que l’exécutif gouvernemental québécois a déposé le projet de loi 61 tout récemment. Cela dit, un certain nombre de questions demeurent sans réponse. Que se passera-t-il exactement d’ici la fin de l’année? Quelle sera, au final, la somme des dépenses publiques réalisées lors de la pandémie? Comment les différents pouvoirs politiques bourgeois, au Canada et ailleurs dans le monde, combleront les déficits? Quel sera l’impact des nouvelles dettes et de leur remboursement sur la lutte des classes? Au fond, pour trouver des réponses à ces questions, il faut s’attarder à la relation entre les dépenses annuelles, les déficits budgétaires et la dette nationale. Il faut surtout examiner comment la bourgeoisie est amenée à mener de front certaines politiques et offensives économiques en raison des mouvements matériels émergents. Évidemment, plus la dette est forte, plus les paiements exigés sont élevés. Dans le contexte de la concurrence impérialiste, le poids de la dette publique est une préoccupation importante pour les différentes bourgeoisies nationales. Dans l’histoire du Québec et du Canada, « l’équilibre budgétaire » et le remboursement de la dette ont d’ailleurs occupé une grande place dans la politique bourgeoise et dans les débats qui ont fait rage au sein de la bourgeoisie. Plus encore, « l’équilibre budgétaire » et le remboursement de la dette ont donné lieu à des mouvements de contestation dans la population québécoise et canadienne en général. Surtout, ces enjeux ont une dimension internationale et touchent l’ensemble des économies capitalistes et leurs États.
À la sortie de la pause économique et aux suites des dépenses colossales liées à la pandémie de COVID-19, la bourgeoisie se penche plus que jamais sur ces questions et ces enjeux. Le « déficit budgétaire » est sur toutes les lèvres. Dans cette veine, le gouvernement fédéral déposera, le 8 juillet, un « Portrait de l’économie et des finances publiques » canadiennes. Au provincial, le 19 juin, le gouvernement a soumis le « Portrait de la situation économique et financière 2020-2021 ». De son côté, la ville de Montréal a demandé le droit de pouvoir réaliser un déficit dans son budget de 2020, et ce, alors que les villes n’ont habituellement pas le droit d’être déficitaires.
La dette, les dépenses et le déficit au Québec et au Canada
Les États possèdent ce qu’on appelle une dette nationale. Elle représente l’argent emprunté et le crédit à rembourser. Autrement dit, elle comprend l’ensemble des engagements financiers pris par l’État national. Ici, au pays, la quasi-totalité de la dette est due au Trésor du Canada. Ce dernier, qui émet les bons du Trésor, constitue un outil financier pour que la dette des gouvernements puisse être gérée. Il existe d’ailleurs des formes semblables dans les autres pays du monde. En achetant un bon du Trésor sur les marchés financiers (bons émis au Canada par tranches de 1 000$, 5 000$, 10 000$, 25 000$, 100 000$ ou 1 000 000$), un acheteur prête de l’argent à l’État. Les bons du Trésor sont d’ailleurs une forme de produit financier recherchée, car ils figurent parmi les placements les plus « sûrs ». Au Canada, le profit financier sur les bons du Trésor est fait au « rendement » (ailleurs dans le monde, il peut être fait sur « l’intérêt »). Pour illustrer la méthode du « rendement », imaginons que l’État vende à escompte (à rabais) un bon d’une valeur réelle de 10 000$. Il fixe donc son prix à 9 900$. Plus tard, à terme, il rachète à l’acheteur ce bon, mais à son prix nominal, soit à 10 000$… À titre indicatif, actuellement, le « rendement » au Canada est de 0,19%. En 2019, il était plutôt de 1,60%. Il est à noter que les bons nationaux sont côtés par les agences de crédit internationales qui émettent un indice reflétant la « crédibilité » du paiement à terme. C’est ainsi que les États capitalistes ont la garantie d’obtenir du financement.
Sur le marché financier des bons du Trésor, il est important de savoir à qui la dette est due, et surtout, quels pays et quels investisseurs étrangers détiennent une partie des bons, car dans la lutte inter-impérialiste, l’achat d’une part importante de la dette nationale d’un État met l’économie nationale de celui-ci dans une position de faiblesse et de dépendance financière envers une puissance étrangère. Le cas des États-Unis est révélateur de cet affrontement impérialiste : la Chine possède 5,6% de la dette nationale américaine, soit 1,18 trillions de dollars. Autres faits intéressants : en 1960, 4% de la dette publique canadienne était due à des investisseurs étrangers. Entre 2009 et 2014, ce pourcentage est passé de 15% à 27% en plus d’avoir atteint 30% en 2012-2013. Cependant, même à ce niveau, la dette canadienne envers l’extérieur demeure inférieure à celle d’autres pays du G7. À titre indicatif, en 2013-2014, l’on rapportait que 64% de la dette de la France était détenue par des investisseurs étrangers, 62% pour l’Allemagne, 48% pour les États-Unis, 33% pour l’Italie, 29% pour le Royaume-Uni et 8% pour le Japon. Il est à noter qu’il faut ajouter la dette privée (touchant les particuliers et les entreprises nationales) à la dette publique des gouvernements pour avoir un portrait général de l’état dans lequel se trouve une économie nationale.
La dette publique varie selon les nouveaux déficits : ils créent un manque à gagner au niveau du « solde budgétaire » qu’il faut « couvrir » en empruntant davantage. Le solde budgétaire d’un gouvernement pour une année financière est formé par l’écart entre les revenus et les dépenses; un déficit survient lorsque les dépenses sont plus importantes que les revenus. En contrepartie, un surplus survient lorsque les revenus sont plus élevés que les dépenses. Les dépenses sont donc directement liées aux déficits et à l’accumulation des dettes nationales. Les revenus de l’État sont extraits des taxes à la consommation, de l’impôt sur le revenu des particuliers, des cotisations pour les services de santé, de l’impôt sur le revenu des sociétés, des taxes foncières et scolaires, des droits et permis, des revenus des entreprises gouvernementales, etc. En fait, la plus grande part des revenus de l’État bourgeois provient de la plus-value prélevée à même le salaire des particuliers (36% des revenus en 2019) et des taxes à la consommation (24% des revenus en 2019). Aussi, il est à noter qu’un État peut enregistrer un surplus annuel tout en demeurant lourdement endetté. Ce fut d’ailleurs le cas en 2019 : le Québec a enregistré un surplus de 1,4 milliards de dollars tout en traînant une dette nette de 199,1 milliards.
Cette année, la plus grande partie de la dette totale du pays ne proviendra pas des déficits réalisés en 2020, mais bien de ceux réalisés dans les décennies passées. En 2017, la dette publique nette du Canada représentait 35,7% du PIB, soit 759 milliards de dollars. Elle a légèrement connu une augmentation depuis 2007, année à laquelle le taux le plus bas des dernières décennies a été atteint, soit 29% du PIB (605 milliards de dollars). En 1994, la dette canadienne représentait pourtant 66% du PIB, soit 863 milliards de dollars. Autrement dit, la période qui s’est déroulée entre 1994 et 2007 a marqué les esprits… et les portefeuilles! Elle est caractérisée par l’objectif du fameux « déficit zéro ».
Au début des années 2000, le Québec était la 2e province la plus endettée du Canada. Après 15 ans de « redressement budgétaire », le Québec se trouvait désormais au 4e rang avec une dette brute de 204 milliards de dollars, soit 55% du PIB, et une dette nette de 186 milliards de dollars, soit 51% du PIB. Au 31 mars 2020, la dette brute du Québec passait à 197 milliards de dollars, soit 43% du PIB, et à une dette nette de 171 milliards. Il est à noter qu’au Québec, la dette brute équivaut à la dette émise sur les marchés financiers à laquelle l’on ajoute les engagements du gouvernement envers les régimes de retraite et les autres avantages sociaux futurs octroyés aux employés de l’État et à laquelle l’on soustrait le solde du Fonds des générations. Cela dit, il existe de nombreuses méthodes comptables pour calculer la dette et pour donner un caractère « enviable » aux états financiers nationaux. Sur cette base, il est d’ailleurs difficile de comparer les différentes dettes nationales. Selon la CIA, en 2017, la dette brute représentait 89,7% du PIB au Canada, 98% en France, 82,3% aux États-Unis, 87% au Royaume-Uni, 131,2% en Italie, 64,1% en Allemagne et 223,8% au Japon. Selon le FMI, en 2017 toujours, la dette nette représentait 87,65% du PIB en France, 82,26% aux États-Unis, 78,7% au Royaume-Uni, 119,88% en Italie, 45,09% en Allemagne et 153,04% au Japon.
Au Québec, l’on évalue à entre 12 et 15 milliards de dollars le déficit que l’on enregistrera en 2020-2021, soit 3,5% du PIB. Pourtant, avant la pandémie, l’on prévoyait plutôt enregistrer des surplus de 1,9 milliard de dollars. Évidemment, le déficit sera principalement généré par les dépenses en santé et les autres dépenses qui sont au service de la relance économique. Au Canada, en mai, l’on parlait d’un déficit se chiffrant entre 150 et 200 milliards de dollars, soit entre 10 et 12% du PIB. Le montant est beaucoup plus élevé au fédéral qu’au provincial, car le financement du capitalisme canadien passe principalement par ce palier de gouvernement et non par les provinces. C’est donc le gouvernement canadien qui a lancé les grands programmes coûteux que sont la subvention salariale, la Prestation canadienne d’urgence et le prêt garanti de 40 000$ pour les PME. C’est ainsi que le les capitalistes inactifs et les capitalistes des secteurs jugés « essentiels » ont été financés pendant la pause économique.
Le 8 juillet prochain, le gouvernement du Canada soumettra un état des lieux économique. Celui-ci comprendra les dépenses du gouvernement fédéral liées à la COVID-19, une comparaison avec ce qui s’est fait ailleurs, ainsi que des scénarios pour les mois à venir. Une telle « sortie » sera importante, étant donné le retour « à la normale » de la démocratie bourgeoise. En ce sens, les partis d’opposition espèrent enfin trouver dans cet état des lieux des lacunes et des dépenses inutiles pour pouvoir attaquer l’exécutif au pouvoir. On doit donc assurément s’attendre à ce que l’impact des dépenses récentes et à venir sur le déficit et sur la dette anime l’opposition au Parlement. Déjà, l’on spécule sur un déficit qui atteindrait 260 milliards de dollars. Aussi, l’opposition réclame avec hâte une mise à jour économique, voire le budget de l’année 2021. Mais plus largement, la bourgeoisie veut connaître avec précision son état financier et sa position dans l’échiquier mondial.
Les dépenses liées à la pandémie de COVID-19 : une réalité commune
Contrairement à l’idée que l’on peut se faire, le Canada n’est pas le plus grand dépensier dans la crise. Il n’arrive même pas proche de la tête de la liste des États en matière de réponse nationale fiscale et économique à la pandémie. Le Fonds monétaire international (FMI) a déjà recensé une partie des dépenses nationales à partir des données déjà disponibles. De manière globale, l’on remarque que des dépenses astronomiques ont été faites partout sur la Terre pour préserver le capitalisme national et pour ne pas perdre au change devant les adversaires économiques. Le FMI révèle que le Canada a réalisé 148 milliards de dollars de dépenses directes (8,4% du PIB), la France, 133 milliards (5% du PIB), l’Italie, 90 milliards (3,1% PIB), le Japon, 1 060 milliards (21,1% du PIB), l’Allemagne, 181 milliards (4,9% du PIB) et les États-Unis, 2 900 milliards (14,5% du PIB). En plus des pays déjà énumérés (et en se basant uniquement sur les données disponibles, loin d’être exhaustives), l’on recensait les pays suivants devant le Canada, toujours en termes de dépenses directes (portion du PIB) : la Nouvelle-Zélande avec 21%, la Grèce avec 14%, le Qatar avec 13%, Macao avec 12,1%, Singapour avec 11%, la Suisse avec 10,4%, Hong Kong avec 10%, l’Iran avec 10%, l’Australie avec 9,7%, la Thaïlande avec 9,6%, l’Autriche avec 9% et le Kazakhstan avec 9%. En ce qui concerne les prêts garantis et l’achat d’actifs, le Canada a dépensé 170 milliards de dollars, la France, 300 milliards, l’Italie, 500 milliards, le Japon, 14 milliards, l’Allemagne, 825 milliards et les États-Unis 4 000 milliards. L’on peut conclure que partout dans le monde, les États capitalistes ont fait des dépenses pour stimuler et soutenir leur économie nationale respective. Les « programmes économiques de la COVID-19 » relevaient donc d’une nécessité économique et non d’une conception particulière en matière de dépenses publiques.
En avril dernier, le FMI prévoyait que les fermetures temporaires généralisées et la grande pause économique du printemps 2020 entraînera les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression de 1929, conséquences qui seront certainement bien pires que celles de la Grande Récession de 2008. L’on parlait alors de 3% de « contraction mondiale » pour l’année 2020 (alors qu’on avait enregistré une « croissance mondiale » de 2,9% en 2019). L’on situait les États-Unis à -5,9%, l’Allemagne à -7%, la France à -7,2%, l’Italie à -9,1%, l’Espagne à -8%, le Japon à -5,2%, le Canada à -6,2% et le Royaume-Uni à -6,5%. L’on prévoyait aussi, pour les principaux pays industrialisés, une baisse des exportations de 12,8% et des importations de 11,5%. Aussi, le taux de croissance anticipé pour 2021 serait de 5,8% (si des politiques de financement sont adoptées par les économies nationales). Les évaluations du FMI étaient basées sur le scénario d’une pause économique relativement courte et d’une relance à partir de l’été. En fait, le FMI a simplement fait la lumière sur l’intérêt objectif des capitalistes à dépenser des sommes d’argent colossales pour soutenir les processus fondamentaux de circulation et de production du capital. Par exemple, au Canada, la PCU a permis de soutenir la circulation du capital en stimulant une demande assez forte sur le marché. De son côté, la subvention salariale a permis de maintenir un taux de profit suffisamment élevé pour les capitalistes industriels demeuré actifs pendant la pause économique (ou qui ont repris leurs activités au moment de la relance économique) en subventionnant leur capital variable (les salaires). Il a aussi distribué des prêts pour garantir la masse de capital-argent minimalement requise pour la reproduction du capital social et il a subventionné des dépenses de capital constant (comme les loyers commerciaux). Le tout a permis au capital dans son ensemble de tenir le coup. En plus d’avoir traduit la base matérielle prescrivant un mouvement généralisé de dépenses, le FMI a lui-même accordé des prêts, du financement et des consolidations de dettes. En d’autres mots, ce qui a prévalu à l’échelle nationale a aussi prévalu à l’échelle internationale, et ce, en raison de la concurrence.
Le remboursement de la dette au temps de la lutte entre les impérialistes et de la course aux profits : une nécessité partagée et objective
Pour un gouvernement, le remboursement de la dette est habituellement la dépense la plus importante, après la santé et l’éducation. Il n’y a que les pays qui ont un énorme budget militaire de « défense nationale » qui font exception. Pour avoir une idée de l’ampleur de l’endettement des États, deux indices principaux doivent être examinés : 1) le poids de la dette en pourcentage du PIB et 2) la part occupée par le remboursement de la dette dans les dépenses annuelles. Le premier indice nous donne un fait objectif, soit le lien entre ce qui est produit et ce qui est dépensé, donc la capacité de rembourser la dette. Le deuxième indice comporte des éléments subjectifs et contingents : le parti au pouvoir qui produit le budget annuel, le gouvernement en général, les élections à venir, les promesses électorales, etc. Il ne faut pas non plus oublier les incontournables rapports de force à l’échelle internationale et la lutte économique entre les impérialistes.
Si la dette devient trop grande, les paiements dus à échéance augmentent, les taux d’intérêt augmentent aussi, la cote de crédit nationale (attribuée par des agences internationales comme Moody ou Standard Pools) baisse, et les emprunts se font à des taux plus élevés, ce qui peut ainsi donner lieu à une sorte de « spirale infernale ». C’est donc dire qu’à un certain point, il devient indispensable de rembourser la dette. Cette nécessité est renforcée par la concurrence générale que se livrent les différentes économies nationales, concurrence qui touche aussi les exportations et l’investissement de capitaux dans des pays étrangers. À ce propos, les paroles prononcées le 2 juin par Éric Girard, ministre des finances du Québec, sont très révélatrices : « L’argument [selon lequel] les taux d’intérêt sont bas, il est pertinent aujourd’hui. C’est sûr que les taux d’intérêt sont bas lorsqu’on vit la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y aura un rebond. […] On va tout faire pour que l’économie québécoise croisse plus vite, même chose au Canada et aux États-Unis. Alors, on ne peut pas présumer que les taux d’intérêt seront éternellement au même niveau qu’ils sont aujourd’hui. » L’on constate que la menace de voir les taux d’intérêt augmenter fait craindre à la bourgeoisie une détérioration de la situation. L’on constate aussi qu’une lutte généralisée a cours entre les impérialistes pour se soulager du poids de la dette. L’indice du pourcentage du remboursement de la dette dans le budget nous renseigne donc sur les moments où le remboursement de la dette devient une priorité pour un gouvernement, ce qui nous renseigne, par le fait même, sur la dynamique et la conjoncture internationale qui force la réduction de l’importance de la dette face au PIB et qui empêche d’injecter de l’argent ailleurs. Cela nous ramène au mouvement réel qui provoque le remboursement de la dette et non à la croyance que certains gouvernements sont subjectivement et unilatéralement des gouvernements enclins à la « rigueur » et aux « compressions » budgétaires. En vérité, quand ce mouvement réel est lancé, le parti bourgeois qui est au pouvoir, peu importe sa couleur, n’a d’autre choix que d’y prendre part (au prix de se bâtir une « mauvaise réputation » comme le PLQ) et crée une tendance pour les partis qui viennent après lui. Au fond, le « programme de remboursement de la dette », c’est celui de la grande bourgeoisie. Quand celle-ci a intérêt au remboursement, les parlementaires sont élus pour accomplir cette tâche, et ce, peu importe leurs allégeances.
Au Québec, des outils ont été mis en place pour assurer la gestion de la dette : en contrôler le poids et parvenir à la rembourser. C’est le cas de la Loi sur l’équilibre budgétaire. Cette loi interdit les déficits non-justifiés et exige le dépôt formel d’un plan permettant de résorber le déficit. De plus, cette loi met en place une réserve de stabilisation dans laquelle tout surplus doit être déposé. Cette réserve permet de couvrir les dépenses supplémentaires ou extraordinaires (comme celles liées à la pandémie de COVID-19) sans compromettre l’équilibre du budget. En 2006, un autre outil a été adopté par la bourgeoisie québécoise : le Fond des générations, un fond pour les placements financiers détenus par l’État. En 2019-2020, 8,42 milliards de dollars ont été placés dans ce fonds. À terme et en cas de besoin, l’argent placé et les intérêts perçus serviront au remboursement de la dette de la province. Ce fonds est géré par la Caisse de dépôt et placement du Québec créée en 1965 pour gérer l’épargne nationale et des investissements variés. Bref, ces deux outils démontrent à quel point la bourgeoisie est unie derrière le remboursement de la dette nationale. C’est une nécessité objective partagée par tous les partis politiques. La pression inter-impérialiste, les taux d’intérêts, les côtes de crédit, les investisseurs étrangers détenant des bons du Trésor, la dépendance au financement de pays adverses ainsi que l’ensemble des effets de la concurrence forcent les gouvernements à appeler la population à « se serrer la ceinture ».
Faire porter le combat sur le contrôle de la plus-value et ancrer le débat dans les mouvements réels du capital
Face aux déficits énormes, qui seront d’ailleurs annoncés publiquement dans les prochains jours, la bourgeoisie orchestrera de nombreuses attaques contre les travailleurs. Il faudra continuer de dénoncer les conséquences odieuses des coupures budgétaires en matière de santé et d’éducation, en matière de salaires versés aux employés de l’État, etc. Ce combat est légitime et nécessaire. Cependant, il ne faut pas entretenir d’illusions sur les origines et sur les motivations des gouvernements et de l’ennemi de classe : en vérité, d’autres partis bourgeois ne feraient pas mieux que ceux au pouvoir actuellement. Des chroniqueurs, des économistes bourgeois et des partis politiques bourgeois comme Québec solidaire au provincial et le NPD au fédéral insinuent que le fait de couper dans les dépenses publiques ne mènera pas véritablement au « déficit zéro ». Ils proposent donc magiquement de stimuler l’économie avec des dépenses colossales, des « projets de société ». En fait, leurs propositions ne sont qu’un bruit de fond propre au fonctionnement de la démocratie bourgeoise. En vérité, il faut en finir avec des réflexions sur le « keynésianisme », sur le « néo-libéralisme » ou sur toutes autres positions bourgeoises et mystificatrices en matière de dépenses : ce n’est que de l’idéalisme. En plus de prétendre que le gouvernement pourrait finir par rembourser la dette en dépensant toujours plus (!), des formations comme Québec solidaire proposent de faire des dépenses qui ne permettraient même pas d’augmenter la plus-value nationale. Toutes les dépenses ne s’équivalent pas. En effet, subventionner les salaires pour permettre aux capitalistes nationaux d’enregistrer un taux de profit suffisant aura un impact beaucoup plus majeur que d’injecter de l’argent dans la culture, ce qui aurait comme effet de faire circuler la même valeur économique, et donc, ce qui ne contribuerait pas à la production de plus-value nationale. En réalité, les dépenses que les partis au pouvoir choisissent de faire sont principalement celles qui stimulent l’économie capitaliste en permettant la conservation des entreprises et du profit, la circulation du capital et des marchandises, la production de plus-value, le soutien pour affronter la concurrence des marchés étrangers sur les biens exportés, et la préservation de la force des monopoles et de la Bourse de Toronto au sein de la concurrence financière internationale. Contrairement aux commentateurs bourgeois et aux partis d’opposition bourgeois « de gauche » avec leurs idées et leurs faux débats en matière de « politiques publiques », il faut faire porter le combat sur le contrôle de la plus-value et l’ancrer dans les mouvements réels du capital. Les attaques que subiront de plein fouet le prolétariat canadien et québécois nous ramènent à la nécessité de prendre le pouvoir d’État pour rapatrier dans les mains des ouvriers toute la richesse produite annuellement. La planification de l’économie passe par le contrôle et la gestion de la valeur, par le contrôle et la gestion des résultats du travail collectif.