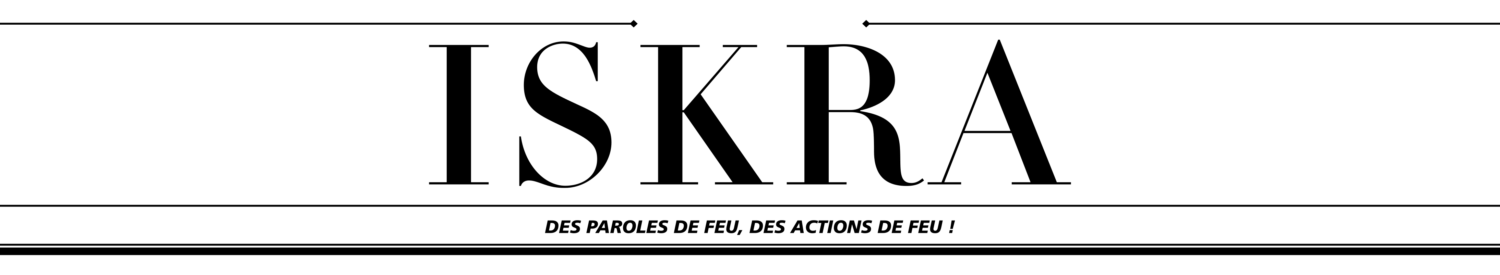L’offre du gouvernement : une insulte aux travailleuses et travailleurs du secteur public
L’offre salariale présentée jeudi dernier aux 550 000 travailleuses et travailleurs du secteur public a été reçue sur le terrain et par les organisations qui les représentent pour ce qu’elle est : savoir une insulte inacceptable, qui appelle une réaction ferme et la mobilisation la plus résolue pour imposer à l’État bourgeois des augmentations de salaires attendues depuis longtemps et plus que légitimes.
Comme tout le monde l’a tout de suite remarqué, l’offre annoncée par le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, implique un appauvrissement continu des salariés de l’État sur un horizon de cinq ans. Alors que les conventions collectives des employés du secteur public durent généralement trois ans, le gouvernement Legault souhaite imposer des augmentations de salaires inférieures à la hausse anticipée du coût de la vie au cours des cinq prochaines années. Concrètement, il propose des augmentations de 1,75 % pour chacune des deux premières années, de 1,5 % pour la troisième année et de 1 % pour chacune des deux dernières années, alors qu’il anticipe lui-même un taux d’inflation annuel de 2,2 % au cours de la même période. Cette offre est si méprisante qu’elle ne devrait même pas être prise en considération par les organisations syndicales lors des pourparlers qui vont s’amorcer dans les prochaines semaines en vue du renouvellement des conventions, dont l’échéance est due le 31 mars.
Plus d’un-demi million de travailleuses et travailleurs concernés
Les négociations du secteur public touchent aux conditions de travail de plus de 550 000 salariés de l’État, qui œuvrent principalement dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux. Les discussions sur les salaires se font à une table centrale alors que celles qui touchent à l’organisation du travail et aux autres conditions de travail se mènent à des tables sectorielles.
Historiquement, les négociations du secteur public ont souvent été des moments forts pour le mouvement ouvrier québécois, dont l’impact se faisait sentir dans tous les grands groupes du prolétariat. On pense ici bien sûr à la bataille historique du « front commun » de 1972 quand les syndicats se sont battus, tous ensemble, pour obtenir un salaire minimum de 100 $ par semaine pour l’ensemble des salariés du secteur public. À tous les trois ans, le renouvellement des conventions collectives donnait lieu à une grande bataille où la bourgeoisie apeurée se rangeait systématiquement derrière son gouvernement, tandis que la classe ouvrière dans son ensemble espérait que les syndicats fassent des gains et ouvrent ainsi une brèche menant à l’amélioration des conditions de travail du plus grand nombre.
Au fil du temps, la bourgeoisie et son État ont repris le dessus, en faisant usage de leur appareil répressif et de leurs instruments de propagande. Lois spéciales, menaces d’emprisonnement, amendes, imposition d’un cadre juridique affaiblissant la capacité de lutte des syndicats (la fameuse législation sur les « services essentiels », qui leur impose de maintenir un niveau de services en cas de grève auquel les citoyens n’ont par ailleurs jamais droit en temps normal !) : tout a été mis en œuvre pour faire en sorte que l’autorité de l’État s’impose aux travailleurs et travailleuses. Parallèlement, les gouvernements successifs ont systématiquement manœuvré pour diviser les rangs des travailleurs et travailleuses, d’une part en « montant » le reste de la population contre les syndiqués du secteur public, d’autre part en divisant ces derniers entre elles et eux, en jouant sur les différentes affiliations syndicales et sur les intérêts prétendument divergents de certains groupes.
À en croire la bourgeoisie, les travailleuses et travailleurs du secteur public étaient « gras dur » et privilégiés ! La moindre amélioration de leurs conditions de travail devait être vue comme un avantage injustifié comparativement à ce qu’on voit dans le secteur privé. En fait, ce que les capitalistes – du privé comme du public – ont toujours craint, c’est que les gains potentiellement obtenus par les syndiqués du secteur public aient un effet d’entraînement sur toute la classe ouvrière et l’incitent à mener partout la bataille contre l’exploitation et pour l’amélioration des conditions de travail.
Un contexte favorable au combat
Pour bon nombre de travailleuses et travailleurs du secteur public, après des années de stagnation et de régression de leurs conditions, le temps est venu de donner un coup de barre et d’obtenir ce qui apparaît comme un rattrapage nécessaire et légitime.
Dans son dernier rapport annuel sur le sujet, l’Institut de la statistique du Québec calcule que la rémunération globale des employés de l’État, incluant le salaire, le régime de retraite et les avantages sociaux, accuse un retard de 6,2 % par rapport à l’ensemble des salariés de la province. Lorsqu’on isole la portion « salaire », cet écart dépasse en fait les 13 %! L’argument de la bourgeoisie comme quoi les salariés du secteur public sont « privilégiés » par rapport aux autres – un argument qui a toujours été trompeur – ne tient tout simplement plus la route. Même s’il n’y a plus de front commun intersyndical et que chaque organisation y va de ses propres demandes, les revendications déposées par les grands syndicats expriment cette aspiration généralisée à une amélioration significative des salaires et conditions de travail.
Même si elle a perdu quelques dizaines de milliers de membres à la suite de la réorganisation du réseau de la santé et de la période de maraudage intersyndical qui s’en est suivi, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) reste la centrale qui rassemble le plus fort contingent de salariés du secteur public. Elle regroupe en effet quelque 150 000 membres œuvrant dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux et dans divers organismes gouvernementaux. Fait intéressant, la CSN revendique une augmentation du salaire horaire de 3 $ l’heure pour tous ses membres pour la première année, renouant ainsi avec une très vieille tradition malheureusement écartée au cours des dernières décennies, soit de se battre pour une augmentation en salaire plutôt qu’en pourcentage de façon à ce que celles et ceux qui sont au bas de l’échelle et subissent les conditions les plus misérables bénéficient d’un rattrapage plus important. Pour les deuxième et troisième années de la convention, la centrale demande une augmentation d’1 $ l’heure ou de 3 %, selon ce qui sera le plus avantageux pour chacun et chacune, ainsi qu’une protection contre une éventuelle augmentation du coût de la vie.
Avec quatre syndicats impliqués dans la négociation (soit le Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat québécois des employées et employés de service, le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau – Québec et l’Union des employés et employées de service), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) représente 55 000 salariés du secteur public, incluant du personnel de soutien technique et de l’administration, des employés de bureau et de la restauration, des préposés, ouvriers spécialisés et concierges, mais également des professionnels et techniciens en santé et en soins infirmiers. Elle revendique des augmentations de salaires de 4,1 % par année et un ajustement additionnel pour les plus bas salariés et ceux qui sont en début de carrière correspondant à 1,1 % de la masse salariale globale.
Aux chroniqueurs grassement payés qui essaieront encore une fois de nous faire croire que les salariés du secteur public sont des privilégiés, la FTQ rappelle que le salaire annuel moyen de ses propres membres n’est que de 35 572 $. Quant à celles et ceux – au nombre de 24 000 – qui travaillent à temps partiel ou ont un statut d’occasionnels, leur salaire moyen se chiffre à… 27 392 $. On est bien loin de la rémunération d’un Richard Martineau, d’une Denise Bombardier ou de la cohorte de sacs à merde qui sévissent dans certaines radios poubelles et qui ne manquent jamais de déverser leur fiel contre les travailleurs et leurs syndicats.
De son côté, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente 130 000 salariés impliqués dans la présente négociation, principalement dans le secteur de l’éducation. Elle revendique, un peu comme comme la CSN, une augmentation fixe de 2 $ l’heure la première année et 3 % pour chacune des deux années suivantes. Aux tables sectorielles, sa Fédération des syndicats de l’enseignement exige une majoration additionnelle de 8 % au 1er avril 2020, spécifique au personnel enseignant. Quant à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui est issue d’une scission de la CSQ et qui regroupe 45 000 enseignantes et enseignants, elle revendique l’abolition des six premiers échelons salariaux, question d’améliorer les conditions de celles et ceux qui sont moins bien payés et des augmentations annuelles globales de 3 %.
Dans le cadre de l’actuelle ronde de négociations, deux syndicats corporatistes ont par ailleurs formé un « front commun » et convenu de présenter des demandes communes, qu’ils comptent négocier solidairement. Il s’agit de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services (APTS) et de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui ne représentait autrefois que des infirmières et infirmiers mais qui rassemble désormais d’autres catégories de personnel. Ensemble, les deux groupes représentent près de la moitié du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Ils revendiquent des hausses annuelles de 7,2 % pour chacune des trois années de leurs futures conventions collectives.
D’autres groupes, dont les fonctionnaires (SFPQ) et professionnels (SPGQ) du gouvernement, font également partie de la négociation.
L’ennemi commun : la bourgeoisie et son État
Comme on peut le voir, l’enjeu des salaires prendra une large place dans la négociation. On imagine facilement quel force de frappe auraient pu représenter la mise sur pied d’un front commun intersyndical et la présentation de demandes communes au nom des 550 000 salariés concernés… En même temps, cela aurait vraisemblablement créé un cadre plus lourd et contraignant, sous le contrôle de directions qui ont perdu l’habitude de la confrontation et qui envisagent toute négociation sous l’angle des techniques et stratégies de négos systématiquement enseignées dans les facultés universitaires et de leurs propres capacités à opérer certaines manœuvres.
Dans le contexte où il reconnaît certains enjeux liés à ce qu’il appelle la « rareté de main-d’oeuvre », le gouvernement a déjà laissé entendre qu’il bonifierait son offre bidon dans certains secteurs – nommément le personnel enseignant et les préposés en milieu hospitalier. Il compte ainsi accentuer les divisions et faire jouer les intérêts des uns contre ceux des autres. En l’absence d’un front commun, le gouvernement pourrait toutefois se retrouver dans une situation où il aura plus de difficultés à contrôler ce qui se passe et où il pourra être attaqué de part et d’autre. Même si on le dit encore en lune de miel avec son électorat, il pourrait frapper un nœud, alors qu’une bonne partie de la population pense aussi que les salariés du secteur public sont dus pour une amélioration de leurs conditions de travail.
Dès lors où la volonté de lutte des travailleuses et travailleurs du secteur public s’affichera, le soutien que leur apporteront les masses de prolétaires pourrait faire la différence. La classe ouvrière, unie dans la bataille et déterminée à remporter la bataille, peut faire reculer la bourgeoisie et son État.